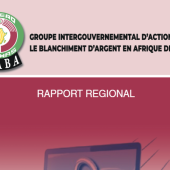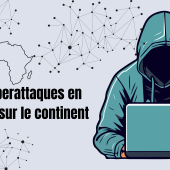Vers une francophonie de la cybersécurité : pour une écologie géopolitique du cyberespace
Une malveillance persistante et sophistiquée
Secret Blizzard, également connu sous les noms de Turla, Pensive Ursa ou Waterbug (punaise d’eau) illustre le visage le plus avancé de la menace cyber contemporaine. Affilié au Centre 16 du Service fédéral de sécurité russe (FSB), ce groupe opère depuis plusieurs décennies et cible bien au-delà du champ militaire : ministères des Affaires étrangères, ambassades, administrations publiques et industries stratégiques figurent parmi ses priorités. Ses opérations, souvent basées sur des logiciels malveillants de pointe tels que Snake, sont destinées à la collecte de renseignements et témoignent d’une capacité de projection offensive à long terme.
La Sainte Trinité de Secret Blizzard
L’approche de ce groupe illustre une tendance préoccupante : l’intégration des infrastructures criminelles tierces dans les opérations étatiques. Plutôt que de se limiter à ses propres outils, Secret Blizzard exploite des réseaux et des vecteurs existants pour multiplier ses attaques tout en complexifiant l’attribution. Cette stratégie, jouant habilement sur l’habitude, l’urgence et l’exploitation des émotions sensibles, traduit une sophistication croissante du cyberespionnage.
La créativité stratégique de l’aigle bicéphale
Pour Mme Sherrod DeGrippo, directrice de la stratégie de renseignement sur les menaces chez Microsoft, « La Fédération de Russie est la définition même d’une menace persistante avancée : créative, persévérante, dotée de ressources considérables, hautement organisée et capable de conduire des opérations sur le long terme. En fin de compte, le mot clé est créativité. » Ce constat souligne une réalité incontournable : la menace cyber n’est plus seulement une question technologique, mais un levier géopolitique d’influence et de pouvoir.

Une écologie géopolitique de la cybercriminalité
L’exemple de Secret Blizzard révèle que la cybercriminalité n’est pas une série d’actes isolés, mais une écologie criminelle mondiale. Ces dynamiques ressemblent aux interactions complexes du vivant : équilibre instable, interdépendance des acteurs et cycles d’adaptation permanents. Pour analyser et anticiper ces menaces, je propose une lecture stratégique que j’ai nommé le « Cadre théorique de DiBento », fruit d’observations issues de missions ethnographiques en Afrique centrale, où la confrontation avec une nature souveraine et intacte m’a inspiré ce parallèle entre écosystèmes biologiques et cybernétiques.
Le Cadre théorique de DiBento : un modèle inspiré du vivant
Fondé sur l’axiome que « le cyberespace obéit à des interactions analogues à celles des écosystèmes naturels », ce cadre conceptualise les rapports de force numériques en sept dynamiques inspirées de la biologie : prédation, parasitisme, symbiose, commensalisme, compétition intra-spécifique, mimétisme et course évolutive. Chaque cyberattaque devient, dans cette perspective, le reflet d’un comportement écologique. Ces catégories, illustrées par des espèces emblématiques du continent africain, offrent aux décideurs et diplomates un outil stratégique pour comprendre, anticiper et réguler la cybercriminalité à l’échelle mondiale.
Prédateurs numériques : la guerre asymétrique
Rançongiciels, sabotages d’infrastructures critiques, attaques DDoS : ces prédations visent la destruction immédiate pour obtenir une rente rapide. Comme le lion d’Afrique, qui cible les proies les plus vulnérables pour optimiser son énergie, les cyberprédateurs choisissent leurs victimes selon la rentabilité et la faiblesse de leurs défenses.

Parasites numériques : l’espionnage persistant
Chevaux de Troie, implants furtifs et logiciels espions infiltrent les systèmes, affaiblissant leur hôte sans le détruire. Ils rappellent le Plasmodium falciparum, parasite responsable du paludisme, capable de se cacher dans le sang et de détourner l’énergie de son hôte, tout en échappant aux défenses immunitaires.
Symbiose criminelle : l’alliance État-Pirate
Certains groupes bénéficient d’une immunité territoriale en échange de services offensifs. Ce mutualisme stratégique évoque la relation entre les fourmis africaines et les pucerons : les fourmis protègent leurs partenaires contre les prédateurs et, en retour, récoltent leur miellat. De même, certains États protègent des hackers pour exploiter leurs talents offensifs.
Commensaux numériques : les profiteurs invisibles
Ces acteurs mineurs tirent avantage des failles ouvertes par d’autres sans toujours nuire directement à l’hôte. Ils évoquent le pique-bœuf d’Afrique, cet oiseau qui se nourrit des parasites présents sur les buffles, zèbres ou rhinocéros, profitant de leur présence sans les menacer.
Compétition intra : la guerre des clans numériques
Les rivalités pour le contrôle des marchés noirs, des bases de données volées ou des rançons structurent un véritable écosystème criminel. Cette dynamique rappelle les luttes de pouvoir entre babouins chacma : les mâles dominants se disputent l’accès aux ressources et au territoire, ce qui renforce la hiérarchie et la cohésion du groupe.

Mimétisme et désinformation : l’art du camouflage
Phishing, faux sites, hypertrucages et infox exploitent la confiance et trompent la vigilance. Ce phénomène reflète le caméléon africain, maître du changement de couleur pour se fondre dans son environnement et surprendre ses proies ou éviter les prédateurs.
Une course évolutive permanente : le darwinisme numérique
Chaque attaque entraîne une contre-mesure ; chaque défense suscite une nouvelle adaptation. Ce cycle perpétuel s’apparente à la coévolution entre le mamba noir et la mangouste africaine : le serpent perfectionne ses toxines tandis que la mangouste développe une résistance accrue, créant une dynamique d’innovation permanente.
Un outil stratégique pour la Francophonie
Cette grille d’analyse éclaire la dimension géopolitique de la cybersécurité : elle montre que les menaces ne sont pas des incidents ponctuels, mais les produits d’un écosystème instable et interdépendant.

Dans ce contexte, le Groupe francophone et les États membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) disposent d’une carte unique à jouer. En renforçant leurs capacités de défense, en mutualisant leurs ressources et en proposant une lecture solidaire de cet environnement, ils peuvent peser dans les enceintes multilatérales et promouvoir une vision inclusive du cyberespace : un espace sécurisé, équitable et partagé. L’« écologie géopolitique du cyberespace », telle que la propose le cadre de DiBento, offre ainsi aux décideurs une clé de lecture stratégique pour comprendre, anticiper et influencer les rapports de force numériques à l’échelle mondiale.
Benoist MALLET Di BENTO, Administrateur à DataFranca
Consultant-IC Intelligence culturelle et Francophonie